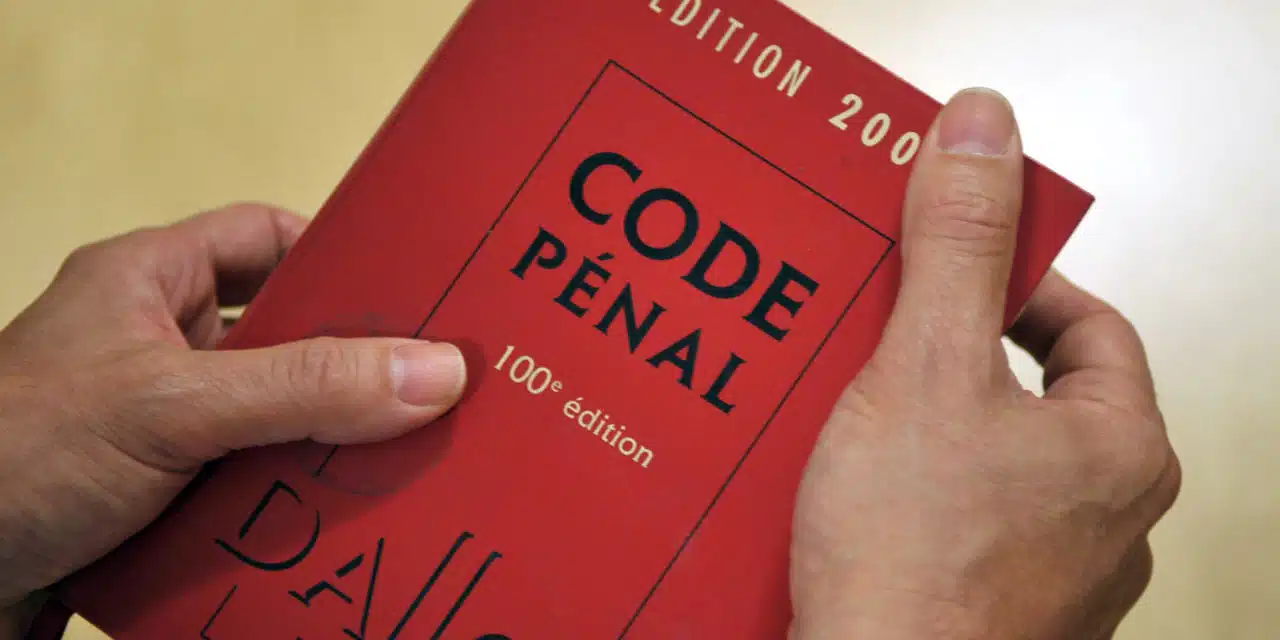Le calendrier officiel ne laisse place à aucun doute : les premiers ordinateurs quantiques pleinement opérationnels pourraient débarquer dès 2030, tandis que la grande majorité des entreprises françaises n’ont pas encore amorcé leur mutation vers cette technologie. Pourtant, certains secteurs voient déjà, au fil des simulations menées en laboratoire, des gains de performance hors d’atteinte pour les supercalculateurs traditionnels.
De nouveaux consortiums industriels se forment dans l’ombre de start-up spécialisées, portées par des investissements publics ciblés. La stratégie nationale s’affiche sans détour : hisser la France dans le trio de tête mondial avant la fin de la décennie.
L’informatique quantique en France : où en est-on vraiment ?
En France, l’édifice de l’informatique quantique repose sur une alliance sans grands éclats, mais solide : le CEA, le CNRS et le monde universitaire, avec Paris-Saclay et Grenoble en têtes de pont. Depuis 2021, le plan quantique a mobilisé 1,8 milliard d’euros, mêlant argent public et fonds privés. Ce coup d’accélérateur se traduit par l’essor de jeunes pousses comme Quandela ou Pasqal, tout autant que par la mutualisation de plateformes expérimentales mises à disposition de l’écosystème.
Concrètement, c’est sur le terrain des laboratoires que se joue l’avancée. L’équipe de Pascale Senellart, à l’institut de nanosciences de Paris, s’impose en pionnière du qubit photonique, tout en tissant des liens avec les industriels à la recherche d’usages inédits. L’agence nationale de la recherche pilote quant à elle une trentaine de projets couvrant tout le spectre, du calcul aux capteurs quantiques nouvelle génération en passant par la métrologie avancée.
Une évaluation sous surveillance
Les choix scientifiques et technologiques ne sont pas laissés à la seule discrétion des chercheurs. L’office parlementaire d’évaluation garde un œil attentif sur les orientations prises. Jean Lautier-Gaud, rapporteur, interroge la solidité des arbitrages et la clarté des critères. De son côté, Neil Abroug, coordinateur national, défend une articulation étroite entre recherche fondamentale et applications, avec un objectif : faire tomber les barrières entre mondes public et privé.
Voici les piliers qui structurent aujourd’hui l’écosystème français :
- Recherche académique : CEA, CNRS, universités
- Start-up et PME innovantes : Quandela, Pasqal
- Financements mixtes : plan quantique, investissements privés
- Surveillance et évaluation : office parlementaire, agences nationales
Face aux mastodontes américains et chinois, la France avance plus prudemment. Mais la dynamique s’installe, portée par la rigueur scientifique et l’ambition de bâtir une industrie compétitive.
Quels secteurs sont déjà concernés et pourquoi cela change la donne
Le calcul quantique commence à faire bouger les lignes dans plusieurs industries françaises, en particulier dans la finance et la chimie. À Paris, Multiverse Computing travaille déjà main dans la main avec de grandes banques pour tester des algorithmes d’optimisation de portefeuilles. Pour un secteur avide de puissance de calcul, la promesse est claire : traiter en quelques minutes ce qui demanderait des heures, voire des jours, aux supercalculateurs standards.
L’industrie n’est pas en reste. Thales investit dans les capteurs quantiques dédiés à la navigation autonome et à la détection de signaux faibles. Grâce aux avancées sur les atomes froids et les qubits supraconducteurs, des précisions inédites se dessinent pour l’aéronautique ou la défense. Derrière ces progrès, on retrouve l’expertise du CEA et des sociétés comme Quobly ou C12 Quantum Electronics, qui développent des processeurs quantiques calibrés pour répondre aux besoins industriels.
Le secteur de la santé expérimente déjà avec Alice & Bob, dont les premiers résultats en modélisation moléculaire laissent entrevoir une conception accélérée de nouveaux médicaments. L’accès au cloud quantique, proposé par Quandela, ouvre la porte à des expérimentations bien plus larges, accessibles aux laboratoires publics et privés.
Différents domaines voient donc s’esquisser de nouvelles perspectives :
- Finance : optimisation, gestion de risques, cryptographie
- Industrie : capteurs, simulation, maintenance prédictive
- Santé : modélisation, recherche pharmaceutique
En bref, l’arrivée de ces technologies modifie l’équilibre. Les secteurs déjà engagés prennent de l’avance, les autres observent, conscients que la vitesse d’adoption du calcul quantique risque bien de redéfinir la hiérarchie industrielle.
Stratégie nationale : la France peut-elle rivaliser avec les leaders mondiaux ?
La France a structuré sa stratégie quantique pour répondre aux avancées rapides venues des États-Unis ou de Chine. Depuis 2021, le plan quantique alloue 1,8 milliard d’euros sur cinq ans, avec une ambition : bâtir une filière complète, de la recherche fondamentale jusqu’à l’industrialisation. Neil Abroug orchestre la coopération entre les grands centres publics, CEA, CNRS, et des acteurs privés tels que Quandela ou Pasqal.
Les financements alimentent des pôles majeurs à Paris-Saclay et Grenoble. La DGA et Bpifrance jouent un rôle moteur dans le transfert industriel. La cryptographie post quantique s’impose comme l’un des axes prioritaires : préserver la souveraineté technologique française, ce n’est pas seulement courir après la puissance brute. L’Union européenne s’implique à travers le programme Quantum Flagship, mais la concurrence de géants comme Google, IBM ou Alibaba demeure féroce.
La France s’appuie sur l’excellence de sa recherche et la densité de ses partenariats internationaux. Mais la prochaine étape se jouera sur la transformation des avancées scientifiques en applications concrètes. L’évaluation régulière des choix scientifiques par l’office parlementaire, tout comme l’engagement des industriels, pèsera lourd dans la balance.
Synthèse des axes actuels :
- 1,8 milliard d’euros engagés sur cinq ans
- Collaboration étroite entre laboratoires, start-up et industriels
- Accent sur la cryptographie post quantique et la souveraineté technologique
Vers un futur quantique : promesses, limites et nouveaux défis à relever
La cryptographie post quantique cristallise l’attention. Face à la menace que fait peser l’algorithme de Shor sur RSA et ECC, les agences comme le NIST, la NSA ou l’ANSSI accélèrent la validation de nouveaux protocoles hybrides. Le calcul quantique promet de repousser les frontières de la simulation de matériaux ou de la résolution d’équations complexes, mais la correction d’erreurs reste le point faible des architectures existantes.
La diversité technologique nourrit les ambitions. Qubits photoniques, qubits de spin en silicium, atomes froids : chaque piste a ses forces et ses limites. Pascale Senellart, directrice de recherche au CNRS, rappelle que tant que le seuil d’une dizaine de qubits fiables n’est pas franchi, la supériorité quantique restera hors de portée pratique. L’enjeu est simple : produire des processeurs capables de réaliser, hors laboratoire, des tâches inabordables pour les machines classiques.
Les obstacles dépassent la technique. La bascule vers le cloud quantique soulève des sujets de souveraineté et de sécurité, tandis que les industriels réclament des débouchés concrets. Philippe Duluc (Thales) et Olivier Reymond (Pasqal) pointent l’urgence de renforcer l’écosystème : formation, normalisation, anticipation des ruptures technologiques.
En pratique, trois fronts se dégagent :
- Validation des protocoles de chiffrement post quantique par les agences nationales
- Multiplication des projets pilotes avec les acteurs du secteur, santé, finance, énergie
- Renforcement de la recherche sur la correction d’erreurs et la montée en échelle
La France n’a pas dit son dernier mot : la partie se joue maintenant, entre promesses fulgurantes et nécessité de bâtir, pas à pas, la confiance et les usages d’un futur quantique. Demain, qui maîtrisera la clef de voûte de cette révolution ?